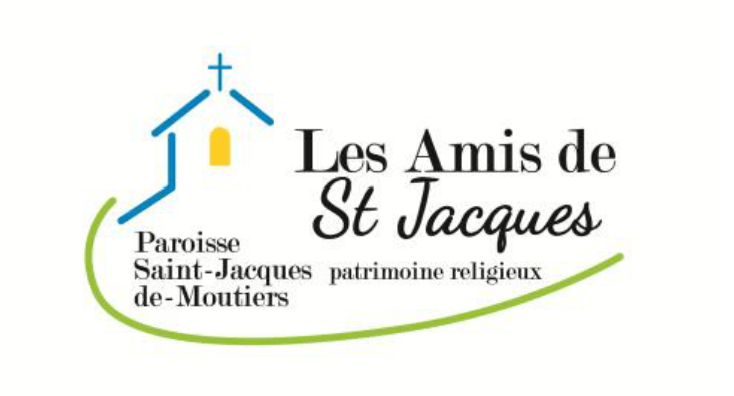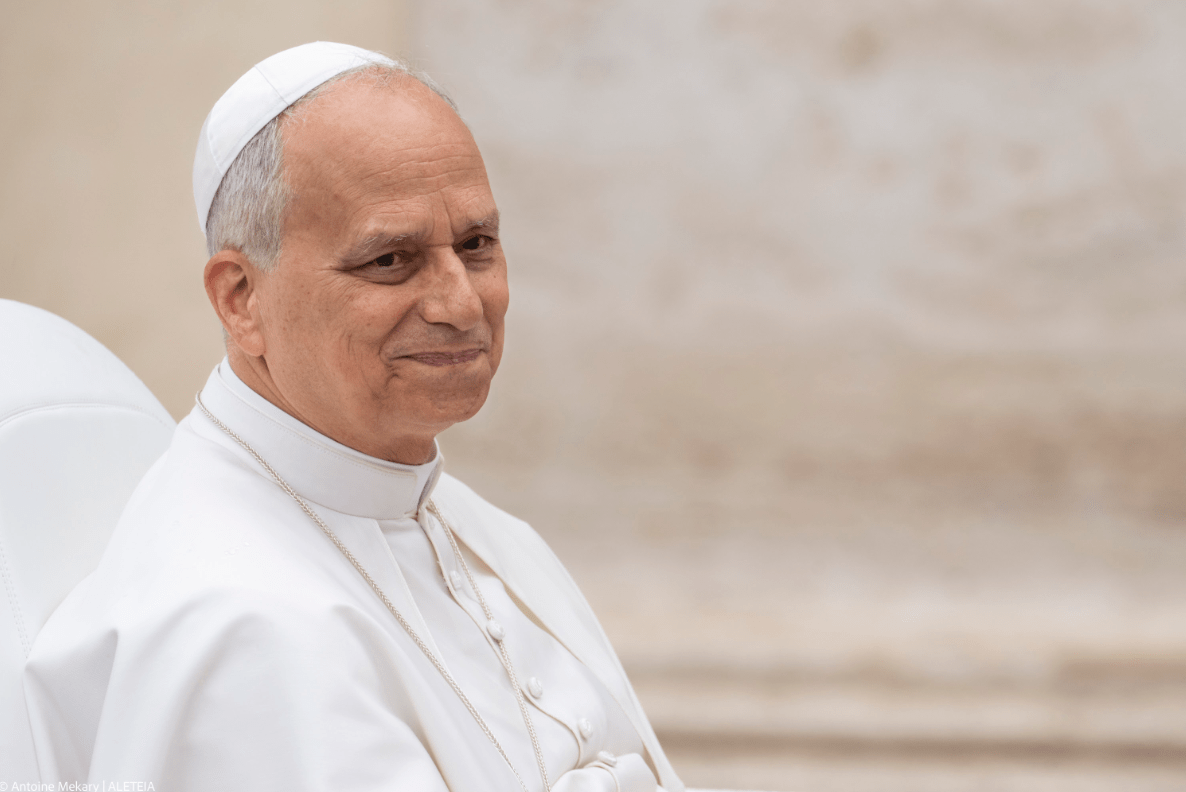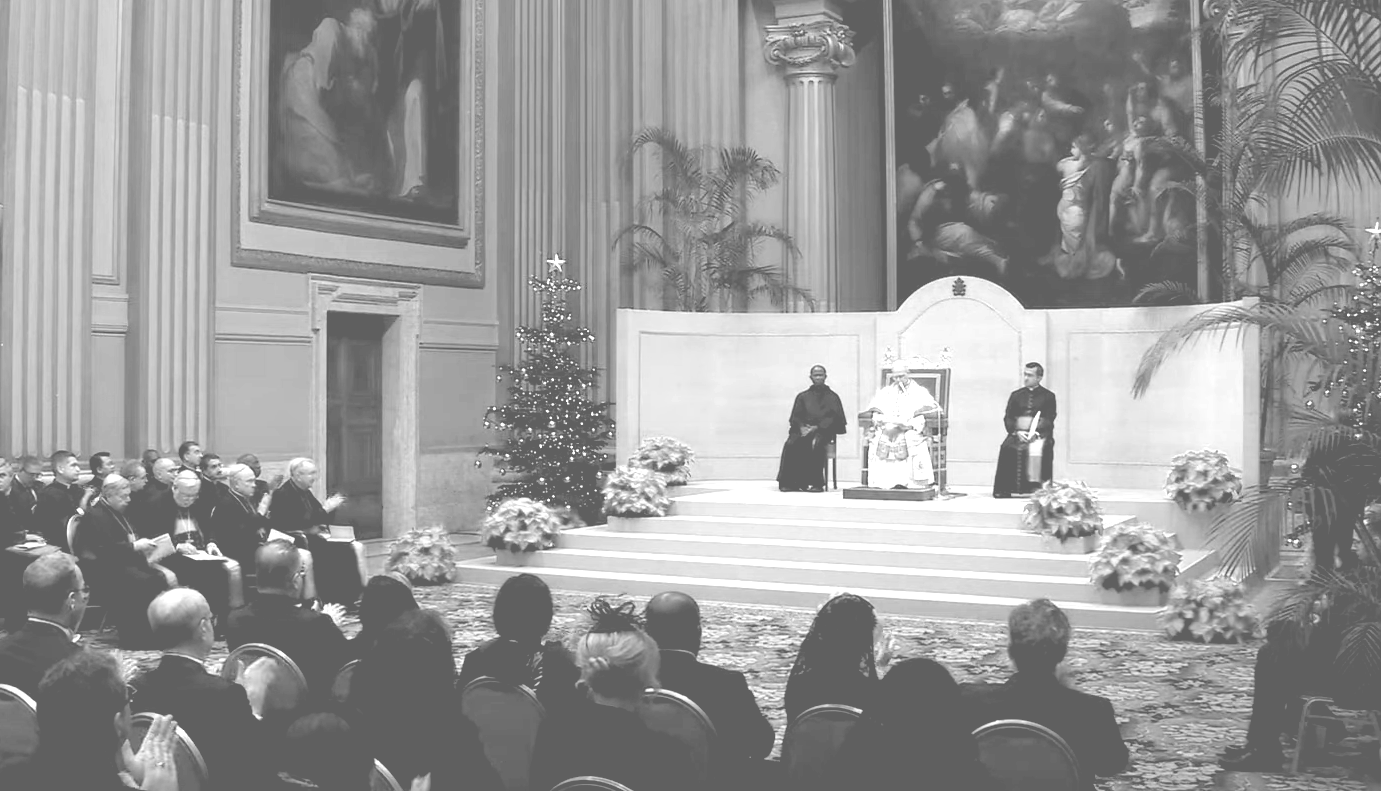Tribune des évêques de France sur la fin de vie
À l’approche de l’examen par le Sénat du projet de loi sur la fin de vie, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France prend la parole. Dans une tribune publiée le 14 janvier 2026, les évêques appellent à une réflexion profonde sur le sens du soin, de la solidarité et de la dignité humaine.
Dans les prochains jours, le Sénat examinera une proposition de loi instituant un « droit à l’aide à mourir ». Ce débat engage notre société dans ce qu’elle a de plus intime et de plus grave : la manière dont elle accompagne ses membres les plus vulnérables jusqu’au terme de leur vie.
Nous, évêques de France, voulons redire notre profond respect pour les personnes confrontées à la fin de vie, à la maladie grave ou incurable, à la souffrance et à la peur de dépendre des autres. L’Église a une longue expérience d’accompagnement des malades ou des personnes en situation de handicap, des aidants, des soignants, des aumôniers d’hôpitaux ou d’Ehpad, et nous entendons l’angoisse de celles et ceux qui redoutent la douleur, la solitude ou la perte de maîtrise. Nous rencontrons directement cette angoisse, quand des personnes proches, des membres de nos familles, des fidèles de nos diocèses, y sont confrontés et nous la partagent. Ces peurs sont réelles. Elles appellent des réponses humaines, fraternelles, médicales et sociales à la hauteur.
Depuis plus de vingt-cinq ans, la France a fait un choix singulier et précieux : refuser à la fois l’acharnement déraisonnable et la mort provoquée, en affirmant à la fois le droit de ne pas souffrir et le devoir d’accompagner la vie jusqu’au bout. Les lois successives, jusqu’à la loi Claeys-Leonetti et, aujourd’hui, la nouvelle loi en cours d’élaboration pour l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, dessinent une « voie française » cohérente, reconnue, fondée sur le développement de la culture palliative, la prise en compte de la parole du patient, les directives anticipées et la possibilité de la sédation profonde et continue, non pour donner la mort mais pour soulager la douleur.
Les soins palliatifs sont l’unique bonne réponse aux situations éprouvantes de la fin de vie et nous exprimons ici notre reconnaissance aux élus qui, par leur vote, soutiennent l’actuelle proposition de loi pour l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs. Beaucoup de soignants engagés dans cette voie témoignent que la prise en considération de la personne en fin de vie ou malade, dans sa dimension physique, mais aussi psychologique, relationnelle et, le cas échéant, spirituelle, telle que le proposent les soins palliatifs, entraîne quasiment toujours chez les patients en fin de vie la disparition des demandes à mourir. Car même derrière une demande de mort, c’est souvent le désir de vivre qui se dit. Pour permettre à tous d’accéder aux soins palliatifs, l’Église, qui est déjà présente dans le monde hospitalier et la pratique des soins, est prête à apporter sa contribution au développement de la culture palliative, en intensifiant son engagement sur le sujet.
Dès lors, une question s’impose : pourquoi une nouvelle loi ? Si l’« on meurt mal en France », comme on l’entend parfois, ce n’est pas parce que l’administration d’une substance létale aux patients n’est pas encore autorisée, mais parce que la loi existante est insuffisamment appliquée et que l’accès aux soins palliatifs demeure très inégal sur le territoire national. Aujourd’hui encore, près d’un quart des besoins en soins palliatifs ne sont pas couverts. Comment proposer la mort comme une option, quand l’accès effectif au soin, au soulagement de la douleur (les progrès médicaux permettent de venir à bout de quasiment toutes les douleurs réfractaires), à la présence humaine et à l’accompagnement n’est pas garanti pour tous ?
Légaliser l’euthanasie ou le suicide assisté changerait profondément la nature de notre pacte social. Derrière des mots qui se veulent rassurants se cache une réalité que le langage tend à dissimuler. Présenter l’euthanasie et le suicide assisté comme des actes de soin brouille gravement les repères éthiques. On détourne les mots de leur véritable sens pour mieux anesthésier les consciences : ce brouillage n’est jamais neutre. On ne prend pas soin de la vie en donnant la mort.
Nous refusons en particulier l’instrumentalisation de notions essentielles telles que la dignité, la liberté ou la fraternité.
Nous rappelons avec force que la dignité d’une personne humaine n’est pas variable selon son état de santé, son autonomie ou son utilité sociale ; elle est inhérente à son humanité, jusqu’au bout. Elle est inaliénable.
La liberté, quant à elle, ne peut être pensée de manière abstraite, comme si la souffrance, la peur, la solitude ou la pression sociale n’avaient aucun impact sur le discernement. La demande d’en finir avec la vie n’est-elle pas une demande d’en finir avec une vie qui ne correspond plus aux critères socialement normés : être en bonne santé, utile, valide et ne pas représenter un poids financier a priori lourd ? La liberté ainsi conçue risque de devenir une pression silencieuse, surtout pour les plus fragiles. La liberté de tout individu doit aussi être envisagée dans sa dimension relationnelle : nous sommes interdépendants et les choix des uns engagent les autres. Faire porter un choix de mort à un malade, à une famille, à une équipe médicale formée pour soigner et non pour tuer, c’est nier le mystère de communion qui nous lie les uns aux autres. Paul Ricoeur invitait à « penser à la responsabilité qu’on a des autres, qui sont confiés à notre soin et à notre garde, et pas seulement à la responsabilité qu’on a à l’égard de soi-même. » [1]
Enfin, évoquer une « loi de fraternité » quand il s’agit de faire mourir, de donner la possibilité de s’administrer une substance létale, ou d’inciter un soignant de le faire contre sa conscience, est un mensonge. La fraternité, valeur centrale de notre République, ne consiste pas à hâter la mort de ceux qui souffrent ou à forcer des soignants à la provoquer, mais au contraire à ne jamais abandonner celles et ceux qui vivent ces moments si difficiles et douloureux. La fraternité invite à refuser définitivement la tentation de donner la mort, et, dans le même temps, à s’engager résolument pour développer effectivement les soins palliatifs sur tout le territoire, à renforcer la formation des soignants, à soutenir les aidants, à rompre la solitude et à reconnaître que la vulnérabilité fait partie de la condition humaine.
Aussi, nous appelons solennellement les responsables politiques à mesurer la portée anthropologique, sociale et éthique de leurs débats et de leurs votes. Nous comptons sur la décision personnelle et courageuse de nos élus nationaux. La vie, à toutes ses étapes et jusqu’à la fin, n’est pas une cause que l’on porte comme une autre, avec des idées toutes faites et l’orgueil de nous croire tout-puissants, mais un mystère à accueillir, avec une écoute attentive de ceux que la souffrance transperce et avec humilité : il faut beaucoup d’humilité pour un peu d’humanité.
Notre motivation n’est pas d’abord ni exclusivement confessionnelle. Nous voulons donner un écho à l’inquiétude profonde exprimée par de très nombreuses personnes malades, personnes en situation de handicap, familles ou soignants. Avec cette proposition de loi, ces derniers seraient encore en première ligne et sommés de poser des actes contraires à l’éthique du soin et au pacte de confiance qui les lie aux patients et à leurs familles ou leurs proches. Le risque est grand de mettre à mal la relation de confiance entre le soignant, le soigné, son entourage proche.
Le vote qui se présente aux représentants de la Nation n’engage donc pas seulement un choix individuel, mais un choix de société. Car au-delà de « l’aide à mourir », c’est la question du sens de la vie, de la souffrance et de la mort qui se pose à nous. Une vie humaine, aussi affaiblie soit-elle, peut-elle décemment être considérée comme inutile au point de s’en débarrasser ? Sommes-nous des êtres parfaitement autonomes ou des personnes qui faisons alliance pour prendre soin les unes et les autres ? L’inquiétude humaine aux confins de la mort est-elle une absurdité à effacer ou une condition de notre existence, à soulager et à accompagner ?
Nous croyons qu’une société grandit, non pas lorsqu’elle propose la mort comme solution, mais bien lorsqu’elle se mobilise pour accompagner la fragilité et protéger la vie, jusqu’au bout. Le chemin est exigeant, certes, mais c’est le seul qui soit véritablement humain, digne et fraternel.
[1] Paul Ricoeur, Accompagner la vie jusqu’à la mort, Esprit, mars-avril 2006, p. 320
Les évêques du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France (CEF)
Cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille et président de la CEF
Mgr Benoît Bertrand, évêque de Pontoise et vice-président de la CEF
Mgr Vincent Jordy, archevêque de Tours et vice-président de la CEF
Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque coadjuteur de La Rochelle
Mgr Sylvain Bataille, archevêque de Bourges
Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Nîmes
Mgr Alexandre de Bucy, évêque d’Agen
Mgr Jacques Habert, évêque de Bayeux et Lisieux
Mgr Alexandre Joly, évêque de Troyes
Mgr Laurent Le Boulc’h, archevêque de Lille
Mgr Luc Meyer, évêque de Rodez
Mgr Pierre-Yves Michel, évêque de Nancy
Mgr Didier Noblot, évêque de Saint-Flour
Mgr Laurent Percerou, évêque de Nantes
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris
Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Sens-Auxerr