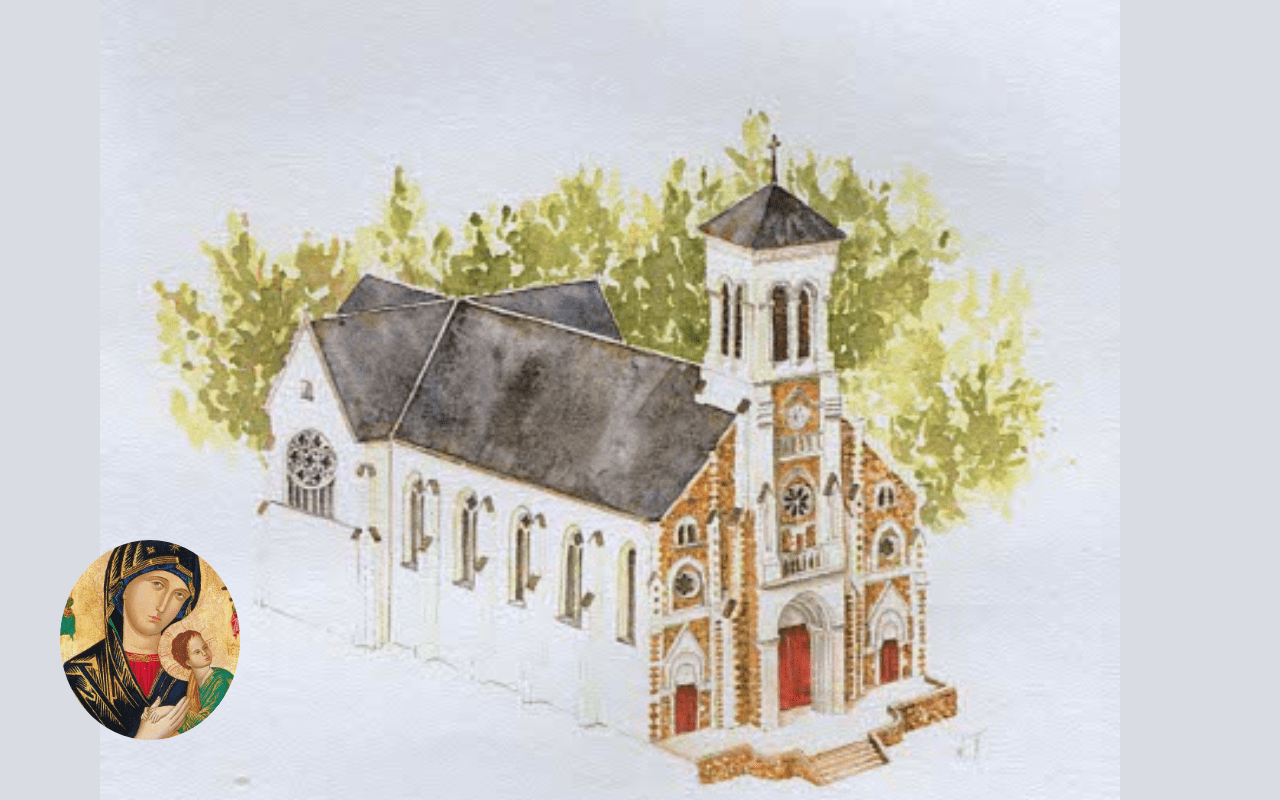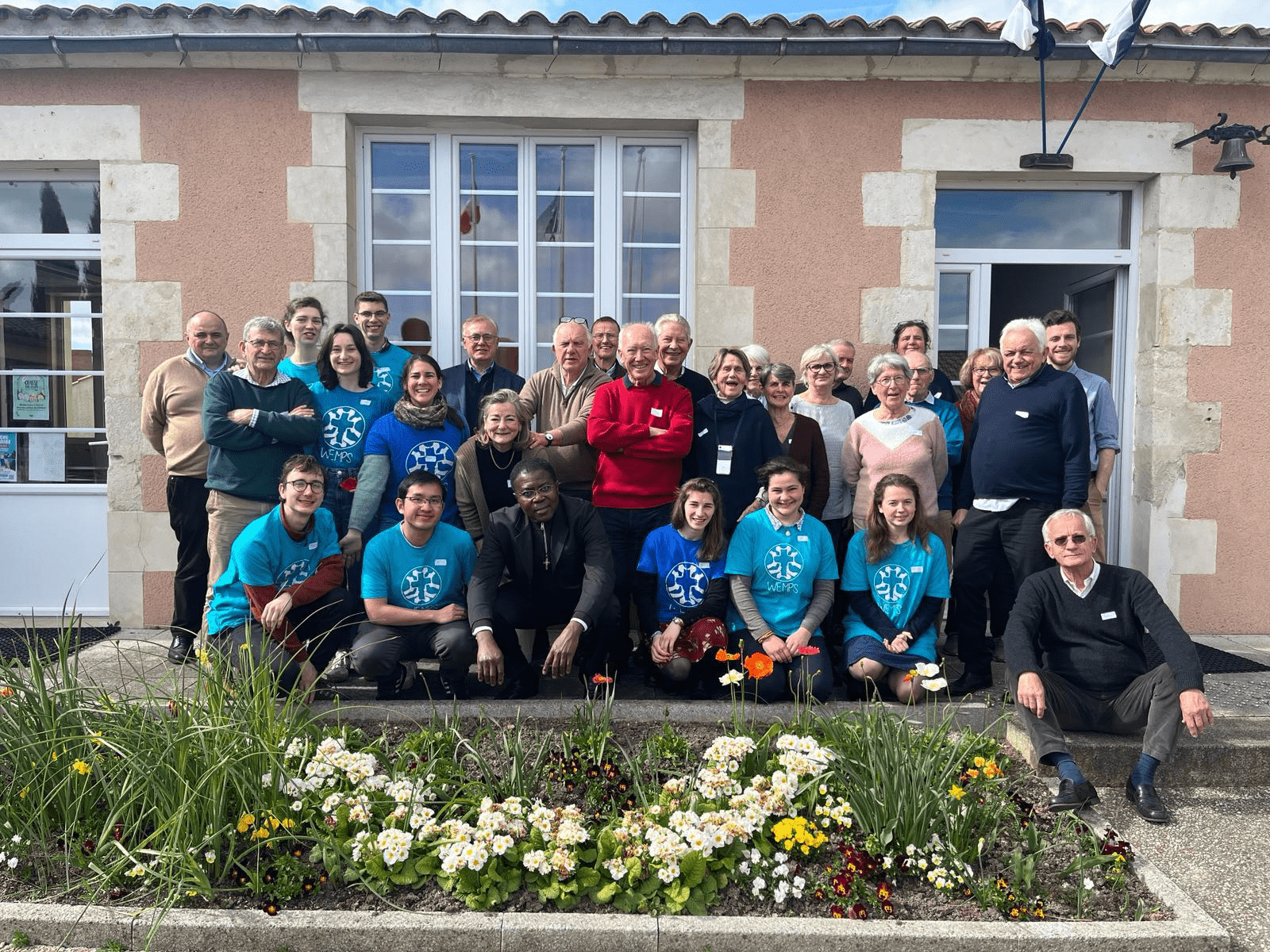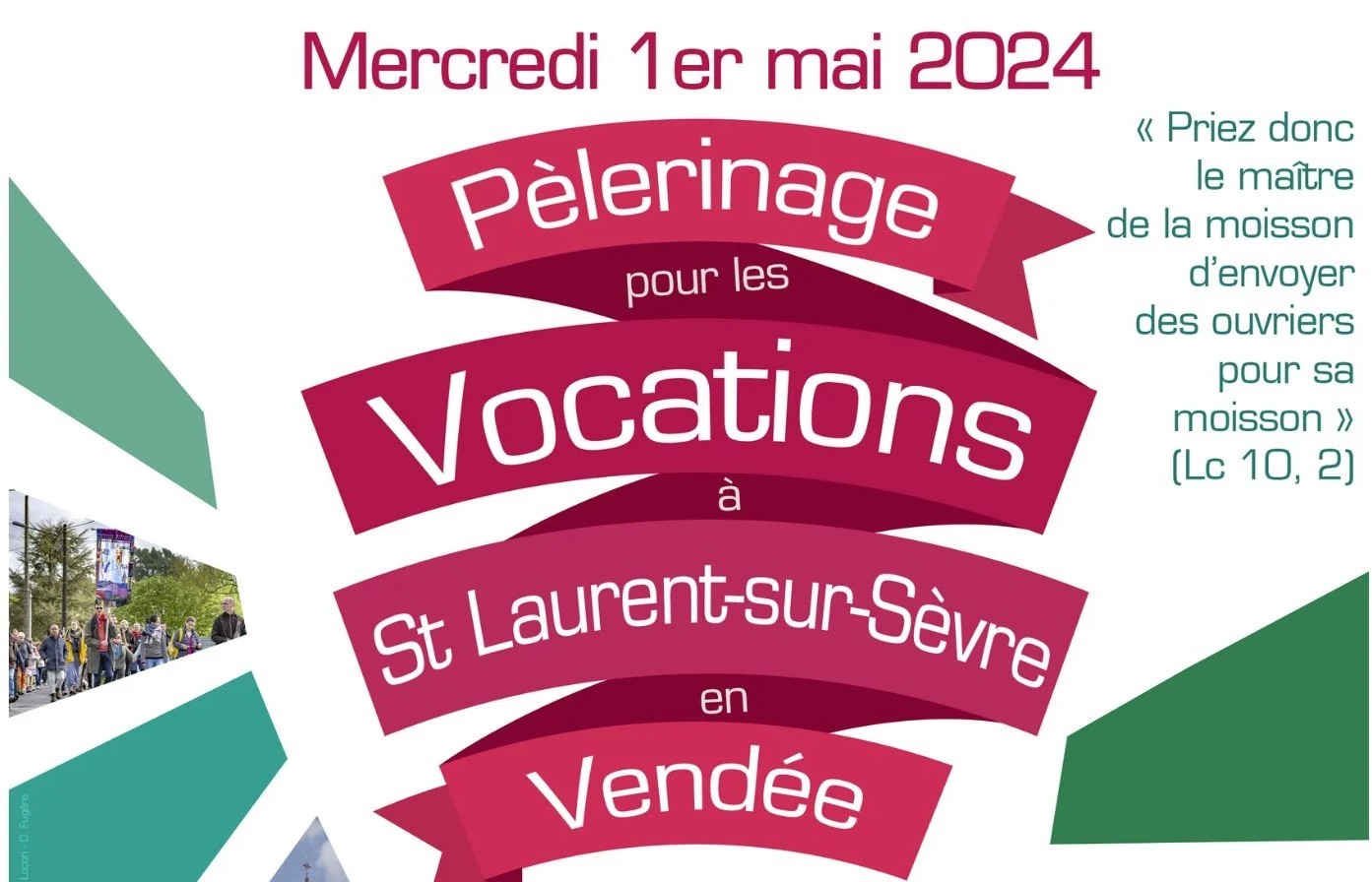Affaire Oudéa-Castéra, mise en place de groupes de niveau sauf dans le privé, contrôle du financement, mixité sociale… Les polémiques qui visent l’enseignement catholique se multiplient ces derniers mois. À tel point que le secrétaire général de l’Enseignement catholique a pris la parole pour défendre un modèle d’éducation malmené, parce que mal compris.
Anne-Sophie Retailleau – publié le 29/02/24
Un mois après le tourbillon médiatique autour de l’affaire du lycée parisien Stanislas, l’Enseignement catholique sort enfin du silence. Son secrétaire général, Philippe Delorme, s’est exprimé dans deux entretiens accordés à Ouest-France et au Monde, ce mardi 27 février. Il est revenu sur les polémiques qui ont secoué l’enseignement privé sous contrat, dont 95% des établissements sont catholiques. « L’Enseignement catholique a été caricaturé », a-t-il déclaré à Ouest-France, faisant référence à la polémique du lycée Stanislas. Un feuilleton médiatique de plusieurs semaines qui aura finalement conduit la ministre de l’Éducation, fraîchement nommée, à quitter la rue de Grenelle. Le 15 janvier dernier, alors que cette dernière déclenche une tempête en justifiant maladroitement la scolarisation de ses enfants au Collège Stanislas, Mediapart publie le contenu d’un rapport d’inspection présenté comme accablant pour l’établissement parisien. Taxé d’élitisme, accusé de « sexisme », de « propos homophobes » ou encore de discours « anti-IVG », Stanislas devient en quelques jours le symbole des dérives idéologiques et financières supposées de l’enseignement privé.
La cristallisation d’une méfiance
Car l’affaire Stanislas a en réalité cristallisé la méfiance grandissante et un sentiment de suspicion d’une partie de la classe politique et médiatique à l’égard de l’enseignement catholique. Un procès injuste pour Philippe Delorme qui, sans nier l’existence de dysfonctionnements à la marge, dénonce « les généralisations » appliquées à un enseignement catholique « mal compris ». A propos de Stanislas, « la conclusion du rapport académique, c’est qu’il n’y a ni dérive homophobe, ni sexiste ou autoritaire, comme cela a pu être écrit », insiste-t-il auprès de Ouest-France. Mais la méfiance est telle que certains ne s’embarrassent même plus du respect de la loi, à l’instar de la Ville de Paris, qui dans la foulée de la publication du rapport par Mediapart, n’avait pas hésité à suspendre ses subventions à Stanislas, pourtant d’obligation légale.
Au-delà de l’affaire de l’établissement parisien, l’enseignement privé est fréquemment pointé du doigt, accusé d’être élitiste et riche. En mai 2023, l’Enseignement catholique a ainsi signé un protocole d’accord avec l’Etat sur la mixité sociale et scolaire, à la demande du ministre de l’époque, Pap Ndiaye. Non contraignant, il est censé encourager les établissements privés à augmenter la part des élèves boursiers dans leurs effectifs, et à proposer des frais d’inscription proportionnels aux revenus des familles. Pour Philippe Delorme, cette vision d’une école privée riche et bourgeoise est totalement erronée. « Les réalités ne sont pas les mêmes d’un territoire à l’autre, explique-t-il. La Bretagne, où près de 40 % des élèves sont scolarisés dans le privé, ce n’est pas la région parisienne avec, c’est vrai, quelques établissements huppés. Il y a une plus grande mixité sociale dans nos établissements de l’Ouest. » Dénonçant par ailleurs l’idée fausse selon laquelle l’Enseignement catholique serait très riche, il assure au contraire que ses moyens financiers sont faibles. Car si l’enseignement privé est financé à hauteur de 75% par des fonds publics, le reste est en partie à la charge des familles qui ne bénéficient pas des mêmes aides que celles dont les enfants sont scolarisés dans le public.
Une guerre scolaire ?
Autre signal de méfiance envoyé à l’enseignement privé, la publication prochaine d’un rapport parlementaire sur le contrôle des subventions à l’école privée est attendue en mars. Co-rapporteur de cette mission d’information sur le financement public de l’enseignement privé sous contrat, le député La France Insoumise (LFI) Paul Vannier, s’est d’ores et déjà félicité de « la fin d’une omerta politique qui aura duré près de quarante ans »…
Privilégiée, bourgeoise, élitiste… Mais d’où viennent ces conceptions peu flatteuses de l’école privée ? Faudrait-il parler de « guerre scolaire », que disent observer certains ? Philippe Delorme réfute quant à lui cette expression. « Régulièrement, depuis la loi Debré de 1959 [qui garantit l’existence de l’école privée, ndlr], l’enseignement catholique est attaqué. Certains n’acceptent pas notre existence, tout simplement », considère-t-il. Mais pour la majorité, le malentendu vient de ce que l’enseignement privé est « mal compris ». « Certains pensent que notre association avec l’Etat devrait nous obliger à faire les mêmes choses que le public. Mais c’est bien pour être différents que nous existons, explique Philippe Delorme. Cela ne veut pas dire qu’on ne respecte pas les règles ou les programmes. »
Mêmes règles et mêmes programmes. Tout comme l’enseignement public, l’école privée doit aussi appliquer les réformes de l’Éducation nationale. Mais la dernière réforme initiée par Gabriel Attal sur la création des groupes de niveau pourrait ne pas être pleinement appliquée dans l’enseignement privé. Cette réforme prévoit que les élèves de 6e et de 5e seront regroupés selon leur niveau pour les cours de maths et de français. Elle nécessite plus d’enseignants, en raison de la nécessité d’avoir des classes aux effectifs réduits pour les niveaux plus faibles. Qui dit réforme, dit aussi moyens pour l’appliquer, et dans ce cas, l’État a d’ores et déjà donné des enveloppes à plusieurs académies pour leur permettre de recruter des enseignants. Problème : dans la distribution des dotations, l’État semble avoir laissé l’école privée sur le banc. Pour appliquer la réforme, elle ne pourra compter que sur 370 emplois en plus. Soit quasiment rien. « L’enseignement catholique n’a reçu aucun moyen supplémentaire pour la mise en place [de la réforme], sous prétexte que nous accueillons des élèves moins défavorisés que dans le public. Seule la suppression d’une heure de cours en sixième nous permet de récupérer 370 emplois ». Ce préjugé risque donc de rendre impossible la mise en œuvre des mesures annoncées en décembre dans les écoles privées, qui accueillent pourtant pas moins de 20% des élèves français.
Article tiré de ALETEIA